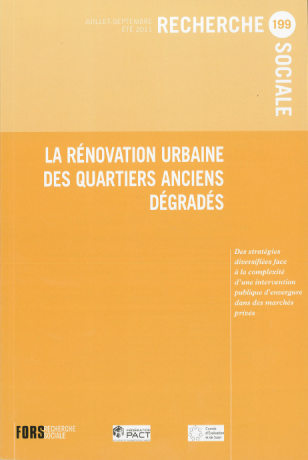La rénovation urbaine des quartiers anciens dégradés
Des stratégies diversifiées face à la complexité d’une intervention publique d’envergure dans des marchés privés
Editorial
Les quartiers d’habitat social composés de grands ensembles construits entre les années 1950 et 1970 sont l’objet prioritaire de l’intervention de l’ANRU. Ils sont aussi les lieux où, dans les faits comme dans les représentations , se concentrent avec une acuité rare les difficultés sociales et les dysfonctionnements urbains. Moins présents dans l’imaginaire collectif, d’autres quartiers – pourtant ni marqués par la formes urbaines des « grands ensembles », ni par la prédominance du parc HLM – font l’objet d’un marquage social tout aussi intense et d’un enclavement urbain important, malgré leur localisation souvent en centre ville : les quartiers anciens dégradés.
Sur les 530 quartiers traités dans le cadre du PNRU, seuls une vingtaine appartiennent à cette « catégorie » de quartiers anciens dégradés. Celle-ci regroupe, au demeurant, des ensembles très hétérogènes d’une ville à l’autre : du coeur historique de Toulon jouxtant le port, à la cité médiévale de Thiers à 30 minutes de Clermont-Ferrand, en passant par la ville « désindustrialisée » de Roubaix ou les quartiers de faubourg de Clichy-la-Garenne qui , limitrophes de Paris, connaissent une certaine attractivité … Bref, autant de contextes très spécifiques auxquels se sont retrouvés confrontés les acteurs du PNRU.
Dans cette nouvelle livraison de notre revue, nous avons choisi de publier les analyses issues d’une étude réalisée, en collaboration avec la Fédération des PACT, à la demande du Comité d’Evaluation et de Suivi de l’ANRU. Cette mission d’évaluation, portant sur le « traitement des quartiers anciens dégradés dans le cadre du PNRU », a été l’occasion d’analyser les apports du PNRU à l’intervention menée jusqu’alors dans ces quartiers, et de mieux comprendre la complexité d’une action urbaine d’envergure dans le cadre de quartiers dominés par des acteurs et des dynamiques privées.
Par-delà ces deux axes d’analyse (apports et limites), ce travail a également mis en exergue les interrogations ambigües des pouvoirs publics quant au devenir de ces quartiers anciens. En effet, au gré des échanges avec les acteurs locaux, ces quartiers nous sont souvent apparus sous deux visages : d’un coté, le quartier réceptacle de précarités, dans lequel trouvent à se loger des ménages auxquels le reste de la ville semble interdit; d’un autre, le quartier de coeur de ville, au patrimoine historique valorisable, perçu comme un espace à fort potentiel auquel on souhaiterait (re)donner de l’intensité urbaine. Ainsi, selon les sites, les stratégies développées au titre du PNRU semblent parfois osciller entre préoccupation sociale (amélioration de l’habitat, relogement, développement de l’offre – très- sociale …) et ambition urbaine renouvelée (équipements vitrines, liens avec la ville, relance de l’attractivité immobilière…). In fine, alors que le Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) a été lancé en 2009, les travaux réalisés semblent montrer que, si une intervention massive était bien nécessaire pour ces quartiers, le cadre d’action proposé jusqu’ici restait à préciser et consolider pour asseoir la pertinence et l’efficacité des investissement consentis au titre du PNRU et autres dispositifs associés.
En complément de ce travail, est présentée une synthèse du rapport 2011 du CES de l’ANRU, intitulé « Les quartiers en mouvement : pour un acte 2 de la rénovation urbaine », que l’étude sur les quartiers anciens dégradés est venue nourrir, au même titre que d’autres travaux sur les dynamiques sociales ou la qualité urbaine des quartiers en rénovation urbaine.
Julien LEPLAIDEUR