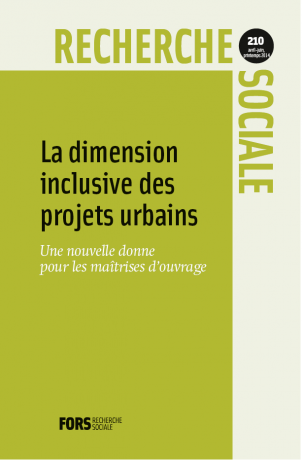La dimension inclusive des projets urbains. Une nouvelle donne pour les maîtrise d’ouvrage
Une nouvelle donne pour les maîtrise d’ouvrage
Editorial
A la veille de fêter ses 50 ans d’existence notre bureau d’études, comme il l’a fait tout au long de son histoire, s’intéresse à la manière dont l’ « urbain » entre en relation avec les problématiques sociales. En l’occurrence, ici, la réflexion porte sur la manière dont les acteurs de la ville, contribuant à la réalisation des « projet urbains », entendent prendre en charge les évolutions de notre société.
La question nous apparait d’autant plus cruciale aujourd’hui que nos travaux sur la précarité et la pauvreté, sur le logement des défavorisés, mais aussi les évolutions de la famille et sur celles du lien à l’emploi nous amènent à dresser le constat d’un affaiblissement de la faculté de la ville » à se faire en faisant société ». C’est en tout cas le sentiment que nous tirons des travaux que nous menons dans des contextes pourtant très différents : projets de rénovation urbaine (PRU), projets d’aménagement en ZAC et programmation habitat, politique en faveur du logement des défavorisés et des précaires. Urbaniser en tenant compte des besoins, des désirs mais aussi des contraintes des habitants des quartiers de ville en construction ou en rénovation semblerait pourtant incontournable. Or, nombre de projets urbains (menés à l’échelle d’un quartier comme à celle d’une ville ou d’une agglomération tout entière) déçoivent ou mettent les acteurs de la ville (élus, aménageurs, promoteurs, agents immobiliers, usagers et habitants … ) en porte-à-faux :
- certaines opérations s’avèrent hors de portée du budget de la plupart des ménages en demande de logement;
- l’acceptabilité sociale des options urbaines mise en oeuvres (formes urbaines, accès, stationnement, …) n’est pas toujours au rendez-vous , générant de nombreux dysfonctionnements et insatisfactions (difficultés d’appropriation, dégradations prématurées, perception négative et rejet du quartier, attentes qualitatives déçues, vie sociale atone au sein des quartiers neufs … ) ;
- la « greffe », parfois, ne prend pas entre les ensembles neufs et les quartiers anciens voisins tant du point de vue de leur « fonctionnement urbain », que de celui de la vie sociale entre les populations anciennes et nouvelles.
Les modes de vie, les aspirations, les besoins de mobilité résidentielle, mais aussi le pouvoir d’achat ont évolué ces dernières années sans que la manière de produire et de concevoir les espaces urbanisés et les programmes immobiliers n’ait vraiment suivi ces changements. Si les crises et les mutations sociétales sont sans doute à l’origine du hiatus croissant entre la ville désirée et la ville produite, il semblerait que les processus de production comme les logiques de conception soient aussi en cause, de par leur rigidité et leur manque d’ouverture aux préoccupations des citoyens/citadins d’aujourd’hui. Que ce soit par leur localisation, par les formes urbaines et architecturales qu’ils proposent, par la conception même des logements ou par l’insuffisance des aménités urbaines et l’inadaptation des équipements et des espaces publics aux usages et aux besoins des populations, les projets urbaines actuels apparaissent souvent en porte à faux par rapport aux besoins réels qui s’expriment dans la société. L’aménagement de certains écoquartiers apparaît à cet égard assez emblématiques de l’écart qui existe entre ce qui est supposé être un « bon » projet et la réalité de la vie sociales qui s’y déploie.
Ces constats nous ont amenés à rencontrer différents professionnels, chercheurs et experts (peu nombreux, il faut le reconnaitre) qui partageaient tout ou partie de notre diagnostic. C’est avec eux que nous avons fait émerger la notion de « Ville inclusive » et ce sont les échanges et les travaux que nous avons pu mener à leurs côtés dont nous voudrions faire état dans cette livraison de notre revue.
S’agissant de notions encore émergentes, de réflexions et de pratiques en devenir, nous souhaitons ici rendre compte du travail de conceptualisation auquel nous essayons d’apporter une contribution. Cela explique le caractère hétérogène des matériaux proposés :
- les actes d’une journées d’études organisée en janvier 2014 en partenariat avec l’Institut d’Urbanisme de Paris sur le thème ; Quels projets urbains pour une ville plus « inclusive »?
- la synthèse des travaux d’un groupe de travail du Club « Ville et aménagement » sur le thème « précarité et aménagement, fabriquer la ville incluante »,
- une profession de foi et des textes de professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme,
- un article destiné à la revue Etudes foncière (dans une première version plus développée).
L’ensemble de ces contributions tend à démontrer de quelle manière la fonction inclusive (ou incluante) de la ville apparait très affaiblie aujourd’hui: ce qui signifie que l’on parvient de moins en moins « à urbaniser sans exclure »; cette exclusion étant de plusieurs ordres : elle concerne autant certains publics (les SDF, les gens du voyage, …) que les mécanismes de cohésion sociale propres au fonctionnement de la ville qui se trouvent amoindris par un certains nombre de partis-pris (le surdimensionnement des espaces publics, des densités mal maîtrisées, des aménagements des voies qui s’articulent mal avec les constructions, des équipements publics conçus davantage comme des « objets architecturaux » que comme des supports favorisant les usages et les pratiques…) sans parler des tendances à « sanctuariser » les quartiers neufs sans lien avec leur environnement qui font qu’à l’heure actuelle, les mécanismes ségrégatifs se renforcent et que la ville se fractionne et se désolidarise.
Sommaire
Quels projets urbains pour une ville plus » inclusive « ?
- La « ville inclusive » : définition et enjeux
- Concevoir le projet ubrain autrement à partir d’une réflexion sur la forme urbaine et sou coût : l’exemple de la démarche du Grand Lyon
- La maîtrise d’ouvrage en question
- La dimension inclusive en actions: » les Ardoines » à Vitry-sur-Seine
- Conclusion et perspetives
PRECARITE ET AMENAGEMENT, FABRIQUER LA VILLE INCLUANTE
FABRIQUER LA VILLE INCLUANTE, QUEL ENGAGEMENT DES AMENAGEURS ?
ANALYSE DES MODES DE CONCEPTION ARCHITECTURAUX
POUR RENDRE A L’URBANISME SES « LETTRES DE NOBLESSE »
ABSTRACTS