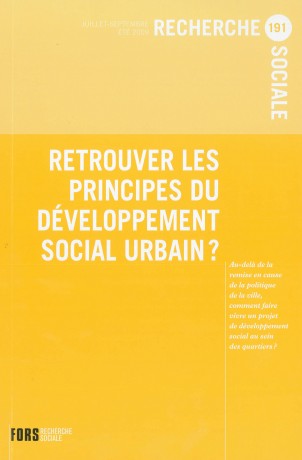RETROUVER LES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN?
Au-delà de la remise en cause de la politique de la ville, comment faire vivre un projet de développement social au sein des quartiers?
Editorial
Dans l’histoire de la politique de la ville, l’intervention sur les quartiers « sensibles » a toujours connu un mouvement de balancier entre le social et l’urbain. Et s’il a pu exister un équilibre social/urbain au tournant des années 70 et 80 avec la démarche Habitat et vie sociale (HVS) et les premières opérations Développement social des quartiers (DSQ), il semble qu’ensuite, lorsque la procédure a pris de l’importance et plus tard encore, lorsqu’elle a été rebaptisée Développement social urbain (DSU), la généralisation des opérations de réhabilitation (via la PALULOS) a fait passer au second plan le projet social. Dans une période plus récente, depuis le début des années 1990, qui correspond à la mise en œuvre des Contrats de ville, la politique du même nom a plutôt été caractérisée par un repli de l’urbain et par un retour de l’intervention sociale[1].
En vérité, il semblerait bien que ce retour à une approche davantage sociale se soit fait par défaut : non pas en raison d’un regain d’intérêt pour cette thématique, mais plutôt par affaiblissement du volet urbain (l’essentiel des réhabilitations avait été mené et les Grands projets de ville manquaient de moyens pour vraiment exister). La période qui a immédiatement précédé la mise en œuvre des opérations de rénovation urbaine s’est donc caractérisée par un certain essoufflement de la politique de la ville, mais aussi par une dilution de ses missions. En effet, cette démarche qui se voulait exceptionnelle et expérimentale s’est retrouvée en charge de tous les dysfonctionnements sociaux d’un territoire : la politique de la ville est parfois devenue le volet « cohésion sociale » des contrats d’agglomération, mais était aussi le cadre d’actions de lutte contre les discriminations, d’actions d’insertions, de réussite éducative, de prévention de la délinquance, de santé…
Trop globale, perdant son rapport aux territoires, il est indéniable que la Politique de la ville a connu un certain épuisement de son modèle d’intervention qui était censé croiser les approches urbaine et sociale, mais aussi et surtout décloisonner les secteurs de l’intervention au service d’un projet. Aujourd’hui, avec l’ANRU, c’est davantage « le hard » qui prévaut (l’investissement et l’intervention sur le bâti, sur les produits proposés et sur le fonctionnement urbain…) et le social arrive au second plan (comme le traduit le fait même que les CUCS ont pu être présentés comme le « volet » social des projets de Renouvellement urbain). Après quelque 5 années d’exercice pour le PNRU[2] et trois années pour les CUCS, il semble nécessaire de faire un point sur les dynamiques à l’œuvre et sur les questions qui se posent encore. Pour cela nous proposons de revisiter un certain nombre de débats qui ont précédé ou qui ont accompagné la mise en œuvre de ces deux dispositifs qui étaient censés se compléter. Et pour ce faire nous proposons d’adopter un point de vue, celui de considérer les enjeux sociaux comme premiers et la politique menée sur les territoires sur le registre du développement social comme utile voire essentielle.
Quatre contributions viennent alimenter ce positionnement. Les deux premières, que l’on doit à Damien Bertrand de FORS-Recherche sociale et à Bernard Pecqueur de PACTE Territoires[3], s’emploient à mettre en avant les « ressources urbaines » et « urbaines » des quartiers sensibles. A l’heure où l’on transforme en profondeur l’aménagement et l’habitat, ils plaident pour que l’on retrouve le sens premier du projet de développement local, en prenant appui sur les « actifs » et les « forces vives » de ces territoires.
Le troisième texte est issu d’une synthèse réalisée à l’occasion d’un séminaire animé par trois membres de Recherche sociale et regroupant l’ensemble des chefs de projet en charge de la politique de la Ville sur la totalité des sites du Grand Lyon. Loin des discours défaitistes, ce texte met en exergue ce que peut être une démarche de développement social et urbain lorsqu’elle est assumée et portée par des élus et des techniciens qui croient en leur projet.
Le dernier texte propose une relecture de quatre contributions de FORS-Recherche sociale qui s’étalent sur presque 10 ans. Elles donnent à voir comment le volet urbain et le volet social ont été questionnés tour à tour, pendant la montée en puissance de la politique de rénovation des quartiers et comment la question de la mixité sociale s’est posée aux prémisses de cette politique. Ce texte explique également comment l’habitat social (ses concepteurs et ses gestionnaires) ainsi que la politique de la ville ont été désignés comme responsables des maux qui s’exprimaient en « banlieue », puis comment la politique de rénovation urbaine a finalement requis les services des professionnels du développement social pour adjoindre un « volet humain » au projet qui avait été voulu essentiellement urbain à l’origine.
Par ces textes, nous signifions l’ancrage historique de notre structure autour des questions de développement territorial, un lien qui date du début des années soixante-dix. Un futur numéro de notre revue regroupera les contributions des intervenants au colloque qui se tiendra le 20 novembre 2009[4] et que nous organisons avec l’Institut d’urbanisme de Paris. Ce numéro permettra de revenir sur la manière dont FORS-Recherche sociale a été étroitement liée à l’histoire de la politique de la Ville.
Didier VANONI
[1] Pour plus de détail sur l’évolution de la Politique de la ville, on pourra se référer au n° 174 de Recherche sociale intitulé « Les projets sociaux de territoire, mieux articuler action sociale et politique de la Ville », Avril juin 2005.
[2] Voir aussi le n° 176 de Recherche sociale, octobre-décembre 2005, Le renouvellement urbain pour quel projet social, Enjeux et débats ».
[3] Bernard PECQUEUR est économiste, Professeur à l’Institut de Géographie Alpine (Université de Grenoble) où il enseigne l’aménagement du territoire et la géographie économique. Chercheur et responsable de l’UMR PACTE-Territoires (CNRS 5194), il analyse les dynamiques productives à travers la notion de développement territorial qui allie théorie du développement et caractère situé géographiquement des comportements et coordinations d’acteurs.
[4] A l’occasion de ses quarante-cinq ans, le bureau d’études FORS−Recherche sociale a souhaité revenir sur l’histoire de la politique de la ville à laquelle il a été étroitement mêlé. Il s’est associé à l’Institut d’Urbanisme de Paris, avec qui il a des échanges fructueux depuis plusieurs années, pour organiser une journée sur l’histoire et le sens de cette politique depuis son origine. Le fil conducteur de ce colloque consiste à questionner ce qu’ont été et continuent à être les intentions politiques de l’action publique menée au titre de la politique de la ville.