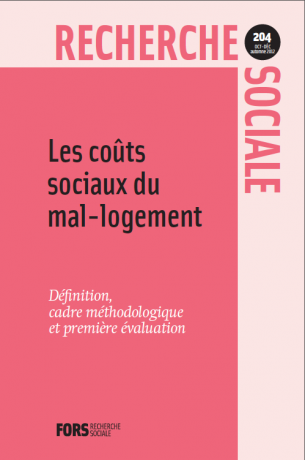Les coûts sociaux du mal-logement
Définition, cadre méthodologique et première évaluation
EDITORIAL
Les acteurs sociaux et du logement témoignent, depuis déjà plusieurs années, de l’impact souvent désastreux de mauvaises conditions d’habitat sur l’insertion sociale des familles et la structuration des individus. De l’absence de logement au manque de confort, en passant par la fragilisation des ménages face au coût du logement et les phénomènes d’assignation à résidence, les formes de mal logement sont multiples et leurs conséquences aussi variées qu’imbriquées : santé dégradée, échec scolaire, difficultés d’insertion professionnelle… Dans le même temps, l’intervention en faveur des personnes sans domicile fixe ou, dans une moindre mesure, la lutte contre l’habitat indigne, sont régulièrement remises en question. En effet, dans un contexte budgétaire contraint, l’incohérence et l’inefficience d’aides orientées sur l’urgence – dont le recours aux nuitées hôtelières constitue l’exemple le plus parlant – ne peuvent être satisfaisantes ni du point de vue des finances publiques ni du point de vue des ménages.
Fort de ces constats, la Fondation Abbé Pierre a souhaité engager des travaux visant à faire prendre conscience des coûts sociaux du mal logement, c’est-à-dire mettre en évidence la charge que cela représente pour la société en termes de coûts induits pour la santé, l’emploi, l’éducation… Au-delà, il s’agissait de faire la démonstration des bénéfices qu’il y aurait à tirer d’un investissement durable dans la politique du logement et d’inciter à un véritable renversement de la logique de réparation qui prévaut encore aujourd’hui. La démarche est ambitieuse puisque jusqu’à présent, aucune approche de ce type n’avait véritablement été entreprise en France. Ce numéro de Recherche sociale présente ainsi la synthèse des travaux exploratoires menés pour la Fondation Abbé Pierre entre 2009 et 2010. Les analyses présentées dans ce rapport ne prétendent pas à l’exhaustivité mais mettent en évidence l’intérêt scientifique et politique d’une approche des problèmes de logement en termes de coûts sociaux et donnent à voir les éléments de connaissance disponibles à ce jour.
En effet, si de nombreuses études anglo-saxonnes ont permis de démontrer l’impact de mauvaises conditions d’habitat sur la santé notamment, on se heurte en France, à la faiblesse de la culture évaluative. L’exercice de quantification des dépenses publiques pour lutter contre le mal logement s’avère ainsi mal aisé en raison de la multiplicité et de la complexité des sources de financement. L’évaluation des coûts induits s’est quant à elle appuyée sur un travail d’identification des conséquences sociales et sanitaires du mal logement avant de proposer, lorsque cela était possible, une première estimation de leur valeur monétaire. Santé physique et mentale dégradée, chances de réussite scolaire mises à mal, difficultés d’insertion ou de maintien sur le marché de l’emploi, risque d’incarcération et de récidive accru, saturation des services sociaux et hospitaliers, etc., ces conséquences sont multiples et entraînent des dépenses parfois colossales dont il faudrait pouvoir rendre compte de manière plus précise. En dernière analyse, elles peuvent aussi être considérées comme participant d’une perte de bien être collectif mettant à mal les objectifs de cohésion sociale.
Dans un contexte de crise économique où les gouvernements successifs se voient imposer des restrictions budgétaires drastiques, la pertinence et l’intérêt d’une telle réflexion n’est plus à démontrer. Appréhender le problème sous cet angle permet en effet, comme le proposait Pierre Bourdieu[1], de réinterroger les logiques qui gouvernent les orientations politiques actuelles : « si nos technocrates prenaient l’habitude de faire entrer la souffrance, sous toutes ses formes, avec toutes ses conséquences, économiques ou non, dans les comptes de la nation, ils découvriraient que les économies qu’ils croient réaliser sont souvent de forts mauvais calculs ». In fine, les éléments recueillis au cours de ce premier travail d’évaluation des coûts sociaux du mal logement donnent à voir l’ampleur du chantier à venir si l’on souhaite se saisir véritablement de ces questions. Cet exercice n’est pas vain puisqu’il a permis de mettre en lumière un certain nombre de coûts tout en témoignant des difficultés rencontrées et des éventuelles lacunes à combler. Gageons que ces travaux pourront être prolongés puisque, suite aux recommandations du Centre National de l’Information Statistique (CNIS), l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) souhaite engager en 2013 une série de travaux exploratoires « à caractère méthodologique » sur le coût économique et social du mal logement.
Juliette Baronnet
[1] Dans une interview à l’Express (18/03/1993)