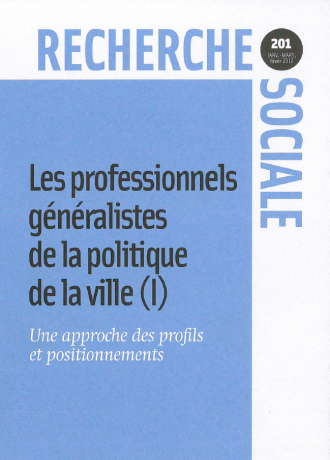Les professionnels généralistes de la politique de la ville (I)
Une approche des profils et positionnements
Edito
L’étude que nous présentons dans cette livraison de Recherche sociale est consacrée à une figure professionnelle particulière, celle du chef de projet politique de la ville. Il s’agit d’une réponse à une commande de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’égalité des chances (Acsé), qui souhaitait actualiser la connaissance et la compréhension de cette « figure historique » des métiers du développement social, afin de renforcer sa stratégie d’animation et de qualification du réseau de professionnels de la politique de la ville.
Prenant acte de l’éclatement et de la segmentation des métiers du développement social urbain, l’Acsé proposait d’appeler ces professionnels des « généralistes de la politique de la ville », rappel de la transversalité de leur mission face à la spécialisation croissante de ces métiers.
L’un des premiers apports de ce travail est celui de la connaissance des professionnels eux-mêmes et de leur évolution. Qui sont aujourd’hui les chefs de projet politique de la ville ? L’enquête menée au près des 548 « généralistes » indique que la « figure historique » du chef de projet militant des quartiers, issu du travail social et caractérisé par une posture de relative extranéité dans les organigrammes des collectivités semble avoir vécu. Elle a cédé la place à une population plus féminine, davantage issue des filières de formation du développement social et de l’urbanisme, mais aussi plus intégrée dans les organigrammes des collectivités locales. La figure du professionnel isolé est également devenue marginale, puisque les chefs de projets, pour la majorité d’entre eux, dirigent ou font partie d’une équipe.
Cette photographie, réalisée en 2010, nous met aussi face à l’hétérogénéité des situations professionnelles, qu’il s’agisse des fonctions occupées, des dispositifs et politiques en charge, des contextes institutionnels d’intervention ou encore de l’intensité des problématiques sociales et urbaines dans les territoires d’intervention…
Ce contexte en évolution et cette hétérogénéité des positionnements professionnels rendent délicate l’analyse de la capacité d’action de ces professionnels – celle-ci étant étroitement dépendante du contexte d’intervention. Dans quelle mesure les chefs de projet généralistes sont-ils en capacité de remplir leurs missions d’analyse et de compréhension des contextes territoriaux, de peser dans les stratégies territoriales, de mobiliser les agents de la collectivité et du partenariat local au service des territoires en difficulté ? Quels sont les positionnements favorables ou défavorables ? Comment expliquer et comprendre les différences très importantes dans les missions exercées comment les relier aux contextes d’intervention ?
Pour répondre à ces questions, il a été choisi une analyse dynamique des positionnements des chefs de projet et de la façon dont ils sont amenés à investir leurs missions. La réflexion sur les déterminants de la capacité d’action des professionnels nous a amenés à les positionner sur des espaces – métiers qui représentent autant de « figures » professionnelles, adossées aux différentes approches de la politique de la ville mises en œuvre par les collectivités. Ces facteurs déterminants des positionnements professionnels n’ont guère changé depuis la création de ces métiers : la conduite de projet de territoire dans la transversalité repose sur une double capacité, celle d’une proximité avec un réseau partenarial de proximité large tout comme avec les instances stratégiques d’une collectivité.
Les quatre figures produites qui sont présentées plus loin – les chefs d’orchestre, les animateurs de territoire, les ingénieurs et les superviseurs – composent certes des idéaux – types. Elaborées cependant de manière très concrète, à partir de l’étude des missions remplies par les chefs de projet, elles ont l’avantage, tout du moins nous l’espérons, de rendre intelligible une réalité professionnelle rendue presque illisible par la diversité des configurations locales et la complexité de la politique publique.
Anne Sauvayre
FORS-Recherche sociale