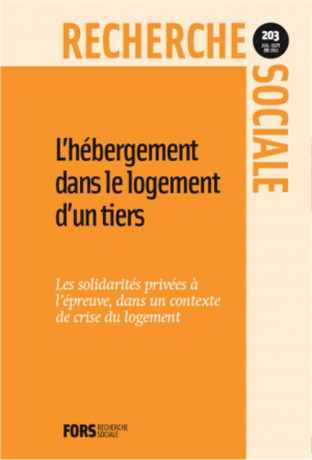L’hébergement dans le logement d’un tiers
LES SOLIDARITES PRIVEES A L’EPREUVE, DANS UN CONTEXTE DE CRISE DU LOGEMENT
EDITO
En 2010, le Plan Urbanisme Construction Architecture initiait un programme de recherche sur « L’hébergement dans le logement d’un tiers : la question sociale et ses enjeux urbains ». Il s’agissait de s’interroger sur la réalité du phénomène en tant que variable d’ajustement invisible de la crise de l’offre publique et privée de logements abordables. Invisible en effet, puisqu’il est possible d’énoncer ici un principe qui a presque valeur de théorème, “l’hébergement n’existe que lorsqu’il pose problème et il ne devient un problème que lorsque l’on s’emploie à le reconnaître en tant que tel ».
Pourtant, la question vaut que l’on s’y intéresse car, comme le rappelle justement le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre[1], : « en réalité, ces formes de non-logement, (dont l’hébergement chez un tiers ou la décohabitation retardée ou ajournée sine die), constituent autant d’amortisseurs de crise, informels mais surtout silencieux et indolores (au moins à court terme) en terme de dépenses publiques » ; c’est pourquoi aussi, il y a un véritable enjeu social et politique à accroître la visibilité du phénomène d’hébergement, alors que certains territoires voient leur fonctionnement fortement affecté (hausse incontrôlée des effectifs scolaires, accroissement des demandes d’aides sociales, etc.) et que s’épuisent des solidarités privées pour le moins précaires.
Bien sûr, il existe un hébergement “soft” qui active des solidarités familiales généreuses ou des solidarités communautaires retrouvées. Bien évidemment, la vie de plusieurs ménages dans un même logement, invitant à partager les mêmes locaux et les mêmes équipements, produit de nouvelles formes d’habiter qui peuvent être bénéfiques au même titre que la colocation entre étudiants. Bien entendu, la proximité durable avec ses enfants d’âge adulte ou avec des parents proches renseigne sur l’évolution d’une sphère familiale aux contours élargis et amène à reconsidérer ce qui fait l’essence de l’intime et l’appréhension du “chez soi”… C’est d’ailleurs tout le paradoxe de l’hébergement que d’être considéré, de l’extérieur, comme résultant de mécanismes de solidarité, mais d’être vécu, de l’intérieur, comme un expédient et de relever d’un “hors jeu” social et institutionnel.
Que les analyses produites dans notre recherche s’appuient sur des exemples issus de situations trouvées en Seine-Saint-Denis, n’ajoute ni n’enlève rien à la gravité des problèmes soulevés. En rendant compte de cas recueillis dans des territoires fortement marqués par la pauvreté et la précarité, mais aussi par la cherté et la rareté du logement, le projet consistait précisément à dégager des éléments qui fondent l’universalité de cette situation de mal logement que représente l’hébergement chez un tiers. L’analyse des parcours biographiques et des conditions de vie de ces hébergés permet ainsi de rendre compte d’une certaine exacerbation des contraintes qui président aux stratégies des ménages devant se résoudre à l’hébergement, révélant des situations proches du sans-abrisme. En proposant une analyse située et contextualisée, nous avons aussi souhaité mettre au jour les logiques institutionnelles qui prévalent à leur prise en charge sur un territoire communal. Enfin, à partir d’une typologie de ces situations, il s’est agi de réinteroger les conditions de leur intégration aux circuits d’aide et aux différentes filières d’accès au logement. Maintenu, voire encouragé par les acteurs sociaux, l’hébergement chez un tiers nous est ainsi apparu, dans sa marginalité même, comme l’un des effets collatéraux de l’impuissance publique, suceptible de renforcer les inégalités teritoriales et d’alimenter les processus d’exclusion.
Juliette BARONNET et Didier VANONI
[1] 16è Rapport sur l’état du mal logement en France, Fondation Abbé Pierre, 2011 (p.27)